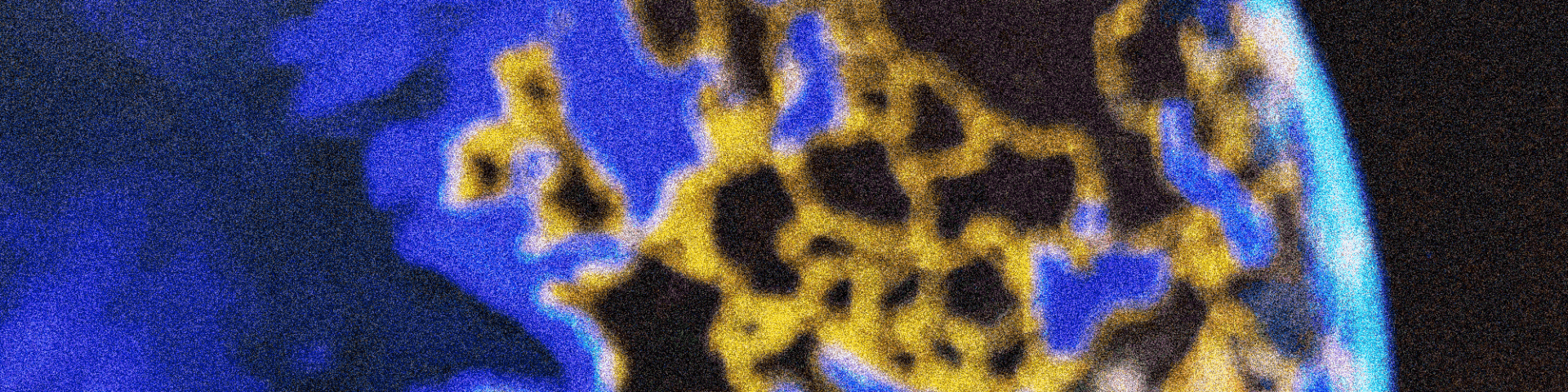L’Union européenne (UE) est aujourd’hui un carcan néolibéral et autoritaire. Pour comprendre comment l’UE en est arrivée là, un retour sur son histoire est nécessaire. Contrairement à une idée qui a souvent cours, l’histoire de la construction européenne est autant faite de continuité que de rupture.
La Communauté économique européenne (CEE) est mise en place par le traité de Rome de 1957. Il s’agit indéniablement d’un traité de libre-échange. Mais la CEE n’est pas que cela. Contrairement à l’Association européenne de libre-échange (AELE) initiée par le Royaume-Uni [[L’AELE, créée en 1960, regroupe à l’origine, outre le Royaume-Uni, le Danemark, la Norvège, la Suisse, le Portugal, l’Autriche et la Suède.]] pour la contrebalancer, cette dernière se fixe un objectif politique, celui d’« établir les fondements d’une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens ». Cet objectif ne peut se comprendre que dans le contexte suivant la Seconde Guerre mondiale. Il s’agit, après deux guerres mondiales, d’assurer définitivement la paix, notamment entre la France et l’Allemagne. Certes, cette construction se meut dans un espace dominé par l’impérialisme américain, mais pouvait-il alors en être autrement dans un monde bipolaire, où l’autre choix était de s’intégrer à la domination soviétique ?
Le traité de Rome prévoit la mise en place d’un marché commun, d’une union douanière et de politiques communes. Il est indubitablement porteur d’une logique libérale, se fixant comme objectif de créer « un marché intérieur caractérisé par l’abolition, entre les États membres, des obstacles à la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux ». Mais, la logique libre-échangiste contenue dans le traité de Rome s’arrête aux frontières de la Communauté car l’union douanière permet la mise en place d’un tarif extérieur commun sur les produits des États non membres de la Communauté.
De plus cette libéralisation, et notamment la suppression progressive des droits de douane entre États membres, se fait dans un espace économique et social relativement homogène, les six pays fondateurs[[Il s’agit de la France, de la République fédérale d’Allemagne, de l’Italie, la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg.]] ayant des systèmes économiques et sociaux proches. Elle ne s’est donc pas accompagnée d’un dumping fiscal et social. Au contraire, cette période voit – au moins jusqu’au milieu des années 1970 – l’approfondissement de la construction de l’État social avec le développement de la protection sociale, une extension des droits des salarié-es et une élévation du niveau de vie des populations.
Enfin, est mis en œuvre un certain nombre de politiques européennes communes, comme par exemple dans l’énergie nucléaire, les transports ou l’agriculture. On peut certes en discuter les contenus, mais elles ne relèvent en rien de logiques libérales. Ainsi par exemple, la politique agricole commune (PAC) se fixe comme objectifs d’assurer la sécurité alimentaire intérieure, un revenu équitable pour les agriculteurs-trices et des prix raisonnables pour les consommateurs-trices, ainsi que de stabiliser les marchés.
Le Marché commun se présentait en fait comme la mise en connexion de marchés essentiellement nationaux. Cela s’explique par la nature du capitalisme, à l’époque, organisé et régulé essentiellement sur une base nationale (le volume du commerce mondial en 1960 ne dépassait pas celui de 1913). De plus, la logique de la concurrence interne à la CEE, contenue dans la Traité de Rome, est contrecarrée par des politiques d’harmonisation.
Ainsi, l’arrêt Cassis de Dijon, rendu par la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) en février 1979, indique que tout produit vendu dans un pays de la Communauté peut être vendu dans les autres pays de la Communauté. Il s’agit d’un arrêt de libéralisation, en cohérence avec l’existence d’un marché commun. Il aurait pu avoir des conséquences très néfastes sur la qualité des produits vendus dans la Communauté, avec des risques sérieux d’un alignement des normes par le bas. Dans les faits, cet arrêt amène les autorités européennes à prendre des décisions d’harmonisation des normes de qualité pour éviter un alignement par le bas.
Cette période voit aussi le début de l’élargissement du Marché commun à des pays beaucoup moins développés (Grèce, Espagne, Portugal, Irlande[[L’Irlande adhère en 1973, la Grèce en 1981, l’Espagne et le Portugal en 1986.]]) que les pays fondateurs, ce qui introduit des éléments d’hétérogénéité importants dans la Communauté. Dans une logique néolibérale, il aurait été tentant d’utiliser ces différences entre pays pour faire entrer en concurrence les systèmes fiscaux et sociaux, mais ce n’est pas ce qui s’est alors produit. Tout au contraire, pour combattre ces disparités, des fonds structurels et de cohésion ont été mis en place afin de permettre à ces pays de rattraper une partie de leur différentiel de développement.
Dans les deux cas, au lieu de laisser jouer la concurrence sur la base du moins disant, des politiques publiques sont mises en place qui tentent de mettre en œuvre une logique d’harmonisation.
La rupture de l’Acte unique
L’adoption de l’Acte unique en 1986 constitue une rupture dans la construction européenne. L’objectif est de mettre en place un marché européen unifié des marchandises, des capitaux, des services et des personnes qui doit se substituer à la cohabitation de marchés nationaux. S’appliquant à une Union devenue hétérogène, précédé par un tournant néolibéral dans la plupart des pays européens – en France c’est le tournant de la rigueur de 1983 – l’Acte unique peut être considéré comme la réponse européenne aux transformations du capitalisme. Celui-ci, essentiellement national dans les années 1950, s’est mué en un capitalisme en voie de globalisation.
C’est à partir de cette époque que les dispositions libérales du traité de Rome prennent tout leur sens. Le droit de la concurrence, inscrit au cœur des traités, devient le droit à partir duquel les élites néolibérales, hégémoniques au sein des institutions nationales et européennes, façonnent l’Union. C’est un droit normatif, véritable droit « constitutionnel » avant la lettre, qui réduit la plupart du temps les autres textes européens à des déclarations d’intention sans portée opérationnelle pratique. La mise en place de l’euro, avec une Banque centrale européenne (BCE) hors de tout contrôle politique et démocratique, l’adoption du « pacte de stabilité et de croissance », qui encadre fortement la politique budgétaire des États, sont censées compléter le dispositif, le refus de toute solidarité financière entre les États de l’Union devant les obliger à un comportement « vertueux ». Se met ainsi en place un gouvernement par les normes. Tout débat démocratique sur les politiques économiques devient dès lors exclu, puisqu’il s’agit de respecter des règles quantitatives contenues dans les traités : équilibre de principe du budget (la « règle d’or »), maximum toléré de 3 % du PIB pour le déficit public, et de 60 % du PIB pour la dette publique.
Que ce soit dans le cadre des Conseils des ministres, du Conseil européen ou des Conférences intergouvernementales (CIG), les États ont gardé la haute main sur la construction européenne. Si la Commission a le monopole de la proposition législative, aucune directive européenne ne peut cependant être adoptée sans l’accord des gouvernements nationaux. Ceux-ci ont, de plus, négocié entre eux, et sans la plupart du temps les soumettre à leurs peuples, les traités successifs. Ainsi, si la construction européenne a vu l’émergence d’institutions supranationales, ce sont bien les États nationaux qui ont décidé, en bout de course, de ses orientations.
L’installation dans le néolibéralisme
L’élargissement de l’Union en 2004 à dix nouveaux pays est le deuxième grand tournant dans la construction européenne. Il transforme l’UE en une zone économique totalement hétérogène. La Commission et les gouvernements y apportent une réponse néolibérale : refus de toute augmentation du budget européen, qui reste de fait plafonné à un montant dérisoire (de l’ordre de 1 % du PIB européen) pour aider réellement les nouveaux entrants, mais dumping fiscal et social et généralisation de la concurrence entre les États. L’option possible de l’approfondissement par la construction d’une Europe politique et le développement de l’harmonisation sociale et fiscale vers le haut est ainsi balayée, au profit de la consolidation d’une zone de libre-échange.
L’intégration de la Charte des droits fondamentaux dans le traité de Lisbonne[[Cette intégration se fait à travers l’article 6 du Traité sur l’UE.]] permet-elle au moins de mettre des garde-fous à cette logique mortifère ? On peut fortement en douter. Non seulement les droits sociaux qui y sont contenus sont de faible portée, mais surtout, pour l’essentiel, l’application de la Charte est renvoyée aux « pratiques et législations nationales ». Ce texte ne crée donc pas de droit social européen, susceptible de contrebalancer le droit de la concurrence. Celui-ci restera le seul droit véritablement communautaire et continuera à primer sur le droit des États membres. D’ailleurs, pour enfoncer le clou, l’article 153 du Traité sur le fonctionnement de l’UE relatif à la politique sociale exclut « toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres ». Tout processus d’harmonisation sociale est ainsi interdit.
L’adoption en 2017, par le Parlement et le Conseil, du Socle européen des droits sociaux ne change pas fondamentalement cette situation. Certes, ce document avance un certain nombre de principes généraux dont la plupart va dans le bon sens, mais est aussi réaffirmé qu’ils « doivent être appliqués en veillant à l’intégrité du marché intérieur ». En clair, le droit de la concurrence continuera à prévaloir sur les droits sociaux.
La mise en place d’un fédéralisme autoritaire
Le traité de Lisbonne a notablement étendu la procédure de codécision entre le Parlement européen et le Conseil de l’UE regroupant les ministres des États membres. Elle couvre aujourd’hui de très nombreux domaines. Il est indéniable que cet accroissement du rôle du Parlement constitue un progrès démocratique. Cependant, ce progrès reste modeste. Outre le fait que des domaines importants lui échappent encore, son rôle est encadré, d’une part, par les traités qui relèvent des États et sur le contenu desquels il ne peut se prononcer et, d’autre part, par la Cour de justice de l’UE (CJUE), qui les interprète, crée de la jurisprudence et donc du droit nouveau.
Machine à créer du droit, l’UE a considérablement renforcé son arsenal juridique suite à la crise financière de 2008 avec pour objectif de renforcer sa crédibilité financière face aux marchés. Il s’agit de promouvoir la soi-disant « règle d’or » budgétaire qui interdit les déficits publics. Le pilotage des politiques budgétaires est désormais assuré par des règles inamovibles assorties de sanctions ; telle est l’essence du Pacte budgétaire imposé à la faveur de la crise de l’euro, et ratifié sans débat par François Hollande dès son élection en 2012, alors même qu’il avait indiqué vouloir le renégocier pendant sa campagne électorale. Mais les règles budgétaires à elles seules sont insuffisantes pour empêcher la divergence explosive des trajectoires des pays membres. Les nouveaux règlements rajoutent à la discipline budgétaire celle du crédit, des balances commerciales et des coûts salariaux[[Pacte Euro-plus de mars 2011. Appelé aussi pacte de compétitivité, il comprend une série de préconisations, allant de l’augmentation de l’âge de la retraite à l’abolition de l’indexation des salaires, dans l’objectif d’une réduction du coût du travail et d’une augmentation de productivité.]].
On a donc l’émergence d’un fédéralisme d’un type nouveau, fondé sur la discipline financière, un fédéralisme autoritaire néolibéral, au sein duquel la souveraineté des États est à la fois mise en commun et entre parenthèses par un système de contraintes juridiques soustraites à la pression démocratique. Comme l’avait exprimé sans vergogne, suite à la victoire de Syriza en Grèce en 2015, le président de la Commission, M. Junker, « il ne peut avoir de choix démocratique contre les traités européens ».
Pierre Khalfa (Fondation Copernic)