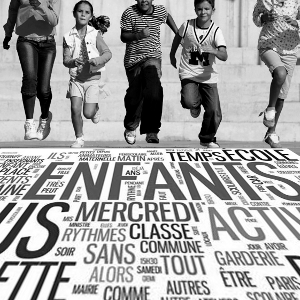L’école d’aujourd’hui reste élitiste et devient dépassée : ses structures (filières, carte scolaires, options…), son organisation (un maître unique dispensateur de savoir face à une classe, évaluations permanentes qui visent plus classement et compétition que coopération…) sont plombées par un tri social des élèves que révèlent toutes les données sociologiques.
L’école d’aujourd’hui fonctionne sur bon nombre d’implicites, socialement connotés.
Les contenus d’enseignement aussi sont discriminants : ils n’ont cessé de croître depuis trente ans, dans un horaire, du moins à l’école élémentaire, diminué de 3 heures face aux élèves, conduisant les enseignant-es à faire des coupes différentes d’une classe à l’autre dans les programmes officiels.
Alors que les questions économiques et celles posées par les sciences sociales s’imposent de fait dans notre société, elles sont réservées à l’élite au lycée, pour la première, enseignées à l’université pour les autres.
Il y a par ailleurs un paradoxe : alors que la culture des classes dominantes est basée sur les « humanités », celles-ci choisissent prioritairement pour leurs enfants les filières scientifiques qui sont les plus sélectives !
Qu’apprendrait-on dans une école vraiment émancipatrice ?
**Culture pour tous vs
culture élitiste
C’est une évidence : les enfants des classes populaires réussissent moins bien à l’école que les autres parce qu’ils n’ont pas les codes pour comprendre ce qui y est enseigné, en un mot, la culture scolaire ne leur est pas immédiatement accessible.
Nous devons nous interroger sur quelle culture, quels savoirs à caractère universel le système scolaire devrait transmettre à toute une génération.
Une autre manière de se référer à un « socle commun » pour tous, mais pourquoi viser 16 ans et non pas l’objectif du bac pour tous, puisque près de 90 % d’une classe d’âge est encore scolarisée à 18 ans ?
Le système actuel transforme les difficultés sociales d’accès aux savoirs en « difficultés » à se les approprier, et conduit à mettre en place des « compensations « (éducation prioritaire…), des « aides » (SEGPA, RASED…) internes, ou des renvois à l’extérieur (CMPP, orthophonistes, accompagnement éducatif, périscolaire…) avec en plus une forte tendance à la médicalisation.
Le débat sur les rythmes scolaires a fait ressurgir une ancienne interrogation : celle des liens entre les pratiques culturelles et les apprentissages scolaires. Les élèves qui réussissent le mieux leur parcours scolaire sont ceux qui baignent dans de multiples pratiques culturelles dès leur plus tendre enfance.
L’école peut-elle intégrer ces pratiques dans son fonctionnement ? Le gouvernement a incité les collectivités locales et non l’école à prendre en charge cette dynamique véritablement discriminante.
On n’imagine pas, ou de manière folklorique, faire entrer dans la culture scolaire ce qui fait sens pour les élèves que l’école ne parvient pas à faire entrer dans son moule ! Ce serait un pas vers une baisse de niveau.
Dans le premier domaine discriminant qu’est la langue, orale comme écrite, pourquoi ne pas former les enseignants à la maitrise du « français langue étrangère » leur permettant d’utiliser les langues maternelles des élèves pour apprendre celle de l’école ?
**Comprendre et agir
sur la société
Mais qu’a-t-on besoin de penser quand on est tout en bas de l’échelle sociale ?
La réponse paraît évidente pour les progressistes en général, et pourtant… Quand on interroge des élèves de collège sur le domaine professionnel et le métier vers lequel ils-elles souhaiteraient s’engager, on trouve dans les réponses le domaine médical (particulièrement les filles d’ailleurs).
Mais la différenciation se fait sur le niveau de qualification : les filles des classes populaires veulent devenir aide-soignante, celles des classes privilégiées seront médecin, le métier d’infirmière seraient une promotion pour les premières, un échec pour les secondes !
Emanciper les futures aides-soignantes, c’est changer les rapports sociaux de travail : ici reconstruire l’hôpital sans rapports hiérarchiques avec un travail moins parcellisé et des prises de décisions plus collectives.
Pour réaliser ce dessein, il est nécessaire que les élèves suivent un même cursus le plus longtemps possible avec, évidemment, dans notre exemple, de la biologie et une découverte des différents métiers du domaine médical…
**Des savoirs « utiles » ?
C’est là qu’intervient la grande question, mise en avant par les néolibéraux, entre autres : « à quoi sert l’école ? »
La réponse, pour eux est évidente : à rendre les individus employables.
L’idée est simple, la division du travail étant de plus en plus marquée, il y a encore des tâches d’exécution, qui deviennent de plus en plus précaires, il faut des travailleurs adaptables avec des compétences simples.
Il faut aussi des travailleurs très qualifiés, eux aussi adaptables, mais avec un niveau de compétences nettement supérieur… une amplitude du bac-3 au bac+3. Avec des contenus cognitifs minimaux et des compétences basiques pour le premier et des savoirs de haut niveau pour le second.
Il faut évidemment s’opposer à cette construction et proposer des parcours communs, une école commune, unique jusqu’à 18 ans avec des contenus communs à tous, ce qui ne veut pas dire une pédagogie unique.
Il faut bien sûr garder les domaines qui permettent de penser et d’agir sur le monde comme la philosophie, la littérature, l’histoire, les sciences etc.
Mais, il faut aussi introduire, pour tous, des notions de compréhension du monde du travail, des techniques et de son organisation : ce sont sur ces bases que pourrait être construite une école polytechnique, qui n’oppose pas les savoirs abstraits aux savoirs concrets.
La mode est aujourd’hui aux « éducations à… ». Loin d’être des outils de compréhension et d’action, elles s’apparentent plus à du « dressage ».
L’éducation à la citoyenneté et sa nouvelle morale laïque va dans le même sens. Il faut, bien sûr, que ces domaines entrent dans les contenus de l’école, mais avec de solides bases de connaissances.
Il est par exemple incompréhensible que l’école n’éduque pas à la lecture des médias (« nouveaux » ou autres)…
**Disciplines ?
Il faut donc enseigner, faire comprendre un monde complexe. Pour y parvenir, on a, de tout temps, divisé les apprentissages en disciplines.
Le mot est bien choisi : cette structuration permet de discipliner la pensée, de l’extraire de son chaos originel. Ces disciplines sont liées à l’histoire, à la géographie, au niveau d’enseignement…
En France, on fait de l’histoire-géographie, en Islande la géographie est reliée aux sciences, au lycée on fait des sciences et vie de la terre, à l’université, de la biologie, de la géologie…
On peut, évidemment s’interroger sur la pertinence du découpage disciplinaire, on doit aussi faire des liens entre les disciplines enseignées ; l’EPS est souvent citée en exemple d’une discipline qui permet d’aborder des notions dans d’autres domaines.
Doit-on pour autant se priver d’outils qui structurent ? Organiser les connaissances et les savoirs reste un moyen indispensable.
Faire comprendre la complexité demande de l’organiser, en particulier faire saisir la collaboration de différentes disciplines dans la résolution de certaines questions de société ou situations- problème.
Les pratiques interdisciplinaires relèvent de « l’innovation » alors qu’elles devraient devenir une forme scolaire véritable.
Présenter aux élèves des situations complexes ne justifie pas de tout mélanger, car son avantage principal (donner du sens aux apprentissages) est nécessaire, mais pas suffisant.
**Quelles pratiques ?
Au-delà des contenus, les pratiques sont aussi à questionner. Pourquoi enseigner une langue étrangère de la même façon à des élèves déjà bilingues et aux autres ? Pourquoi donner un résultat chiffré aux travaux des élèves ? La « bienveillance » n’est-elle qu’une façon d’agir débonnaire ou une pratique destinée à avoir le même niveau d’exigence pour tous ? Il y a la matière à de nombreuses remises en cause.
Et la classe ? Elle peut être le lieu où s’élabore la coopération ou la compétition. Là encore les choix de pratiques ne sont pas neutres.
L’école peut-elle, doit-elle être un espace démocratique, d’apprentissage de la démocratie, pour les élèves comme pour les maîtres ?
Le levier principal de ces évolutions nécessaire est la formation et, bien évidemment la collaboration entre enseignants.
**Une utopie : la coéducation
Pour finir sans conclure, il faut creuser l’idée que les apprentissages ne sont pas forcément qu’une affaire de spécialistes.
Aujourd’hui et maintenant, il est difficile d’imaginer une école dans laquelle chacun pourrait apporter son savoir à tous, nous n’y sommes pas prêts et l’école n’en montre pas la voie : elle nécessiterait une autre organisation sociale du travail. En attendant de construire une école autogérée dans une société autogérée, il existe quand même quelques pistes.
L’école doit d’abord s’ouvrir sur la cité. Et en premier lieu vers les parents, au moins tant que la famille restera le lieu privilégié de l’éducation. Un vrai dialogue doit s’instaurer entre éducateurs, sur les contenus et sur la manière de les transmettre, mais simplement pour échanger sur ce que les enfants apprennent dans leurs différents lieux et temps.
Les apprentissages scolaires peuvent-ils prendre un sens social ?
Foucambert posait la question de « déscolariser » l’école.
Les milieux culturels, sportifs, professionnels, de loisirs qui font l’environnement de l’enfant doivent aussi avoir leur place à l’école et celle-ci doit aussi sortir de ses murs. ●
Danielle Czalczynski et Jérôme Falicon