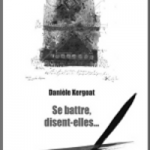ENTRETIEN AVEC… Danièle Kergoat, sociologue, auteure de « Se battre disent-elles »
Danièle Kergoat est une des sociologues françaises les plus importantes, quoique relativement peu connue du grand public. C’est une sociologue
du travail et des mouvements sociaux, et c’est une sociologue féministe.
Elle a publié un livre aux éditions La Dispute en 2012 qui fera date :
« Se battre, disent-elles ». C’est un recueil de textes qui s’appuie sur
des enquêtes sociologiques menées tout au long des quarante dernières années auprès d’ouvrières et ouvriers, d’infirmières, d’employées,
de travailleuses à temps partiel…
Elle met en particulier en relation
les systèmes de domination (de classe, de genre, de race/ethnie…)
avec les luttes menées dans le cadre du travail salarié.
**◗ Qu’est-ce qui te conduit dès la fin des années 1970 à enquêter sur les ouvrières et à prendre en compte leur parole ?
C’est l’état, précisément, de non prise en compte de leur parole, de leurs actes, de leurs personnes alors même qu’à cette époque elles étaient 1.700.000 et représentaient le quart des ouvriers et le quart des femmes actives.
Tandis que la délocalisation en régions de nombre d’entreprises amenait des milliers de femmes au monde industriel. Par ailleurs, si, dans les années 1972-1975, elles avaient mené des luttes dont beaucoup avaient eu un réel retentissement (plusieurs usines de confection, les femmes de Lip, les Nouvelles Galeries de Thionville et bien d’autres), les récits des journalistes étaient toujours au masculin neutre.
Quant au patronat et aux syndicats, ils s’accordaient pour considérer les ouvrières comme une sorte d’archéo-prolétariat, peu susceptible de jouer un jour dans la cour des grands : celle de LA classe ouvrière.
Pour une sociologue, femme, de surcroît venant de milieu populaire, cela posait bien sûr quelques questions ! Entendre traiter les ouvrières d’« hystériques » quand les conditions de travail causaient chez certaines des crises de nerfs, ou quand d’autres barbouillaient de rouge à lèvres les pare-brise des voitures des chefs…
Cela éveillait dans ma tête des échos bien désagréables : la construction sociale de l’hystérie féminine au XIXe siècle par exemple, ou les stéréotypes éculés sur « la » femme, à la déconstruction desquels les féministes travaillaient alors activement.
**◗ Que peux-tu dire de la place inégale des femmes et des hommes au travail aujourd’hui ?

Je dirais d’abord qu’il ne faut pas s’y tromper. L’idéologie libérale veut nous faire croire qu’il n’y a plus d’ouvriers, et encore moins d’ouvrières. Et les masculinistes, que les femmes ont maintenant un pouvoir exorbitant.
De tels propos ont de quoi irriter, d’autant qu’ils sont obligeamment relayés par les médias et certains groupes politiques… Or, non ! les femmes n’ont pas tout le pouvoir et elles ne sont pas prêtes de l’avoir : l’écart des salaires perdure, leurs pensions de retraite sont en moyenne inférieure de 42 % à celle des hommes, elles ont massivement un travail à temps partiel contraint, et les violences continuent de plus belle : dans notre belle France, 1 femme est tuée par son partenaire ou son ex-partenaire tous les deux jours et demi !
Quant aux emplois tenus par les femmes, ils ne sont pas prêts de concurrencer ceux des hommes. Certes, elles sont maintenant plus nombreuses à faire partie des catégories socio-professionnelles supérieures mais, la précarité augmentant, elles sont surtout dans les emplois considérés comme « déqualifiés » (emplois de service, nettoyage, caissières…), le plus souvent en CDD et à temps partiel. Il s’agit bien d’une nouvelle classe ouvrière.
Durant ce temps, la féminisation des mouvements migratoires se poursuit : des pays du Sud et de l’ex bloc soviétique, d’Amérique latine, elles arrivent en masse, fuyant les guerres ou la misère, ne faisant d’ailleurs en cela que se plier aux nouveaux modes d’exploitation du capitalisme mondialisé, et prennent ce qu’elles trouvent comme travail alors même qu’elles ont souvent un niveau d’étude non négligeable dans leur pays.
Bref, de profondes inégalités perdurent entre les hommes et les femmes. Ce que d’ailleurs on peut retraduire en termes de rapports de force entre le groupe des hommes et celui des femmes.
**◗ Tu parles de la difficulté des femmes à s’organiser collectivement.
Qu’est-ce qui rend la lutte collective des femmes si compliquée à se mettre en branle ?
Avant de répondre plus précisément à cette question, il me faut revenir au néolibéralisme : celui-ci organise la concurrence, qui n’est en rien réservée aux femmes.
Dans un contexte de globalisation, nous sommes confrontés à une accélération du mouvement de délocalisation/relocalisation de la force de travail tant masculine que féminine (le rapport production/consommation/reproduction est de plus en plus dissocié géographiquement) et à un processus de déracinement et de désaffiliation profonds.
Dans cette mise au travail généralisé au profit du capital où le chômage massif est nécessaire pour faire pression sur la main-d’œuvre et ses velléités de résistance, on assiste à une redistribution des cartes au niveau mondial tant dans la circulation des capitaux, des marchandises que des personnes.
Elle met en concurrence tous contre tous et toutes contre toutes en dehors de tout cadre réglementaire international alors qu’éclatent les cadres réglementaires nationaux.
Cela, c’est le premier niveau, celui qui concerne les hommes comme les femmes. Construire des solidarités quand on vit dans un contexte de compétition généralisée dans les corps (chômage, précarité) et dans les têtes (individualisme et responsabilisation à outrance), c’est bien difficile.
Mais pour les femmes, d’autres difficultés de taille viennent s’ajouter. D’abord, ce sont toujours elles qui assument l’essentiel du travail domestique : courses, ménage, cuisine, repassage, mais aussi suivi de l’éducation des enfants, prendre soin de la santé de la famille (et souvent même de la famille étendue).
Tout ce travail – car il s’agit bien d’un « travail », d’un vrai travail – ne se fait pas magiquement : non seulement le temps des femmes mères-épouses est drastiquement limité comme l’est également la nécessaire disponibilité d’esprit qu’il faut avoir pour militer.
De surcroît, d’autres difficultés d’un tout ordre surgissent encore : qui n’a pas entendu parler de la « jalousie » des femmes entre elles ?
Ce problème doit être pris au sérieux car il est un frein indéniable à la solidarité. C’est un des points où la sociologie peut être utile. En démontrant que si la concurrence entre femmes est bien réelle, elle renvoie à des mécanismes sociaux : la mise en concurrence entre travailleuses dont l’encadrement use et abuse, la mise en concurrence entre femmes induite par la domination masculine.
Et si quelque chose est construit socialement, alors il peut être déconstruit : c’est ce que je me suis efforcée de faire dans les nombreux stages, en particulier syndicaux, que j’ai animés. Je n’ai su que parfois ce qu’il en advenait par la suite, mais il est certain en tout cas que les stagiaires femmes repartaient en considérant d’un tout autre œil cette « jalousie » qu’elles évoquaient pourtant au début de la rencontre avec tellement d’intensité.
**◗ Si tu devais conclure, tu dirais quoi ?
Que si les femmes doivent lutter plus que jamais, les hommes aussi. Et si possible à leurs côtés. Et lutter non pas contre soi-même, le voisin, l’« autre », mais avec eux, pour eux/elles parfois.
Mais bien sûr, c’est facile à dire, mais moins facile à réaliser. Alors comment amorcer ces luttes, comment lutter contre l’émiettement des mouvements ?
On me pose souvent la question mais il n’est pas du domaine de la sociologie d’y répondre. Je peux donner à voir et analyser les systèmes de domination et leur intrication, mais je ne peux en aucun cas dire la « bonne » forme de lutte, non plus que je ne peux prédire l’apparition de celles-ci (vous vous rappelez le « La France s’ennuie » juste avant mai 68 ?
Et qui aurait prédit il y a quelques semaines la vague de fond brésilienne ?). Par contre, ce que je peux faire, c’est analyser les luttes qui se déroulent de façon à donner à voir le « sujet politique » qui s’est créé à la faveur de cette lutte et qui a transcendé (mais pas nié) les différences et les intérêts contradictoires.
C’est ce que j’ai essayé de faire par exemple avec les ouvriers immigrés de Bulledor qui, en mai 68, avaient mis sous contrôle ouvrier la production et la distribution d’eau minérale.
Ou avec les infirmières qui en 1989, avec leur Coordination, ont mis en place une toute autre forme de pouvoir que celles auxquelles nous sommes habitués : il s’agissait d’un pouvoir dont l’exercice n’était pas lié à la domination, d’un pouvoir diffus, horizontal, collectif, et pourtant opérationnel.
Ces « sujets politiques » nouveaux qui s’expriment dans les luttes, qui veut les voir a l’embarras du choix. Dans l’hexagone ou ailleurs, il y a du désespoir, certes, mais il y a aussi une combativité renaissante sous des formes nouvelles.
Non, le monde en ce moment n’est pas « morose » ! Je dirais plutôt qu’il se cherche… ●
Propos recueillis par R. Pfefferkorn