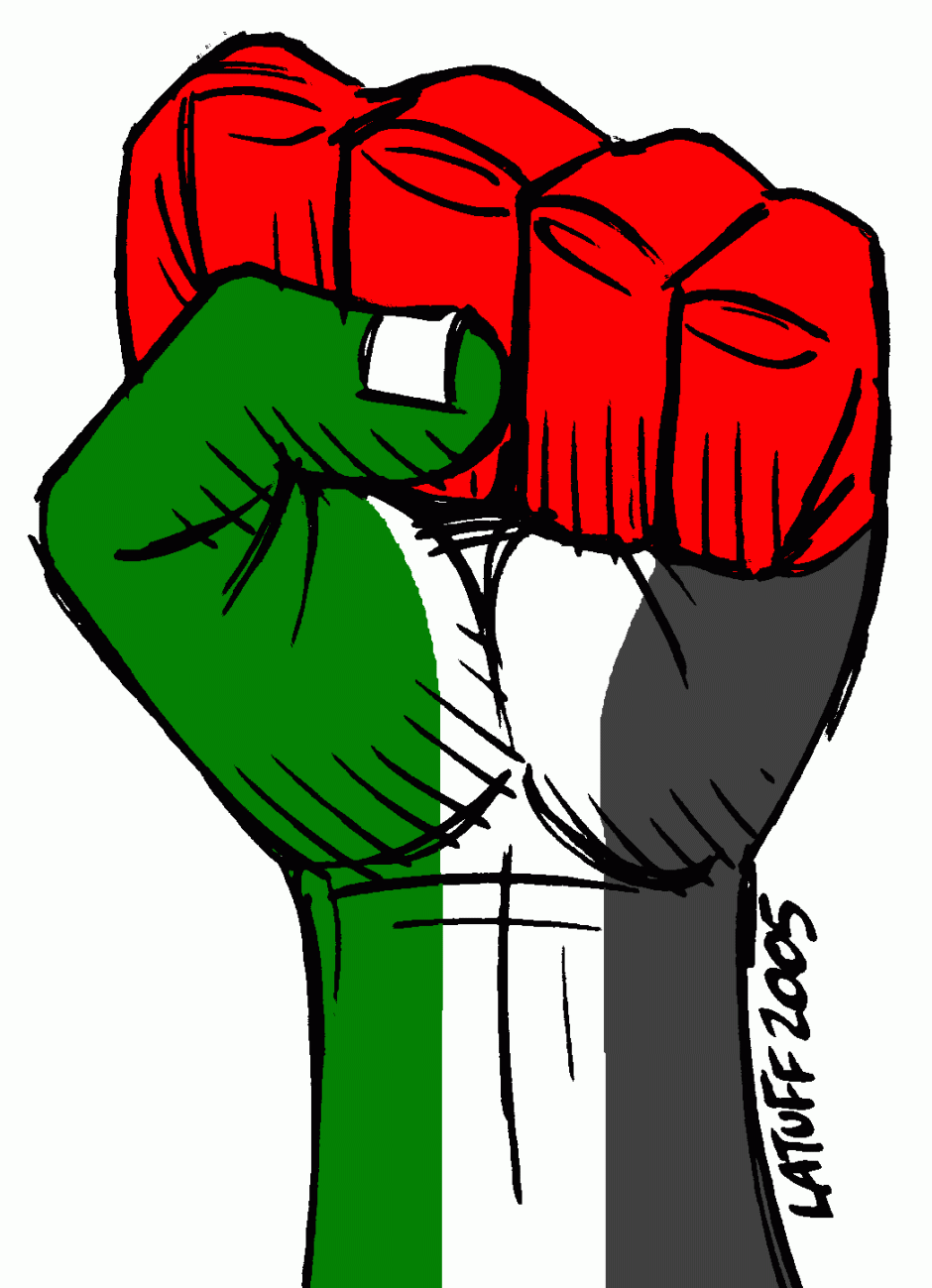Débat général
Les questions internationales peuvent être porteuses d’espoir, comme le montre l’exemple du Népal avec une révolte populaire, marquée dans sa forme par son horizontalité et le rôle de la jeunesse, initiée après l’interdiction des réseaux sociaux et la répression sanglante du mouvement par le gouvernement népalais autoproclamé marxiste léniniste. La colère légitime contre l’autoritarisme et la corruption a amené à une radicalisation sociale qui a ouvert les possibles. Le devenir politique de ce mouvement est incertain avec une tentative des monarchistes hindou nationalistes de revenir sur le devant de la scène. Mais l’exemple nous rappelle que l’irruption des masses populaires sur la scène politique est toujours complexe, qu’il n’y a pas de chimie pure de la révolte et que notre tâche internationaliste reste d’être au côté des peuples, et non au côté de ceux qui proclament les représenter ou des États.
Cette distinction vaut dans les contextes plus proches. Être au côté des peuples c’est tenir les deux bouts celui du soutien politique aux syndicats et aux camarades qui en Ukraine luttent contre la corruption du régime et les politiques néolibérales de Zelensky et promouvoir la solidarité concrète avec l’Ukraine et ses besoins de défense face au colonialisme grand-russe et à l’agression impérialiste de Poutine. Pour ce faire, en France, nous avons à poser plus fortement la question du contrôle social sur l’industrie d’armement, et disons le mot sa nationalisation, car le militarisme Macron, avec 64 milliards d’euros de budget militaire en 2027, prétexte à l’austérité, se fait en faveur de groupes dont la logique reste le profit.
C’est ce qu’ont montré les ventes d’armes qui se sont poursuivies en Europe mais aussi en France vers Israël. La solidarité internationaliste et syndicale des dockers de Marseille a empêché des expéditions dans l’été. Tenir les deux bouts de la solidarité avec la résistance du peuple palestinien, face au colonialisme et au génocide, c’est d’abord défendre les actions concrètes et non seulement (par de là leur importance) le maniement des symboles que sont le drapeau et la reconnaissance de l’État palestinien. Cet évènement diplomatique, tardif, n’est pas anodin, il marque une reconnaissance du droit à l’autodétermination du peuple palestinien. Mais pour que celles-ci soit effective il faut, outre un territoire viable, une autodétermination pleine et entière. Or la déclaration de Macron est conditionnée dans une hypocrisie qui masque mal une posture coloniale qui vise à choisir à la place des Palestinien·nes leur représentant.es. Elle masque mal une complicité concrète avec un génocide, quand les armes sont expédiées, qu’aucune sanction n’est prise contre Israël et que les manifestations de soutien sont surveillées ou empêchées.
Face à cela, nous avons donc une responsabilité particulière , syndicale , à continuer de mobiliser pour l’égalité des droits de la mer au Jourdain, à apporter le soutien de la FSU à la flottille pour Gaza. Il faut aussi continuer à mobiliser pour des sanctions immédiates et investir et promouvoir le mouvement Boycott Désinvestissement Sanctions.
Il faut le faire dans l’unité la plus large avec les forces qui s’opposent au colonialisme israélien et à l’apartheid, notamment dans le cadre du collectif national et nous devons réfléchir aux façons dont le mouvement en France peut gagner en dynamique et non se diviser. Comparé aux mobilisations en Europe, nous rencontrons des difficultés objectives à mobiliser (liée à la répression, au passé et au présent colonial français, aux divisions, à nos insuffisances), mais l’exemple italien d’hier nous donne des pistes. avec des grèves, appelées par les Unione Sindicale di Base (USB), après une demi-journée vendredi, initiée par la CGIL, qui ont rassemblé 500 000 personnes pour dire non au génocide et demander des sanctions contre Israël.
Lever la voix plus fort face au génocide est une urgence, utilisons tout notre registre d‘actions syndicales.