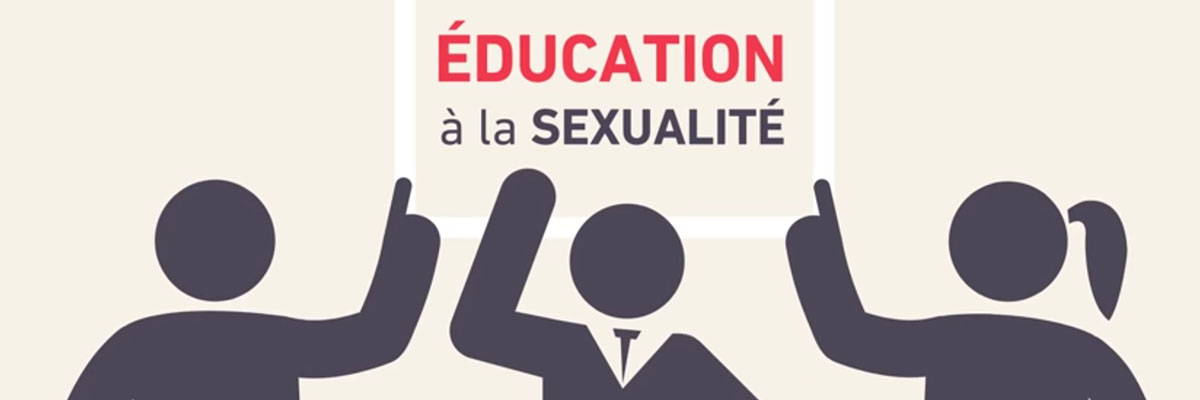L’instabilité gouvernementale est à l’origine du report de l’adoption du programme d’éducation à la sexualité, pourtant attendu par la communauté éducative.
PAR Céline Sierra
Pourtant programmé à deux reprises en juillet et décembre 2024 pour un vote en Conseil supérieur de l’éducation, le programme d’éducation à la sexualité (EAS) n’a toujours pas été adopté faute de stabilité gouvernementale. Ce qui ne l’a pas empêché d’être attaqué, à de nombreuses reprises et sur tout le territoire, par les groupes et mouvances réactionnaires qui usent d’arguments fallacieux pour faire peur et essayer d’empêcher sa publication, donc sa mise en œuvre, de la maternelle au lycée.
Or, ce programme est fortement attendu par la communauté éducative, responsable depuis 2001 d’éduquer à la sexualité tou·tes les élèves à raison de trois séances par an, à tous les niveaux de la scolarité. Mais si cette responsabilité est bien inscrite dans la loi, les circulaires de 2018 et de 2022 qui l’encadrent sont peu précises et ne suffisent pas à définir précisément les enseignements à mener.
Un contenu progressiste
C’est pourquoi, ce programme, qui est à l’inverse grandement détaillé, est considéré par l’ensemble des organisations syndicales représentatives comme une grande avancée pour soutenir les personnels et pour clarifier, y compris pour les familles, ce qu’apprendront les élèves selon leur âge. Le programme est organisé autour de trois axes : se connaître, vivre et grandir avec son corps ; rencontrer les autres et construire avec eux des relations, s’y épanouir ; trouver sa place dans la société y être libre et responsable. Il décline les notions et compétences à acquérir et propose des liens avec les programmes disciplinaires, de la maternelle au lycée. C’est bien par la densité de son contenu et sa progressivité qu’il permettra aux enseignant·es responsables des séances de les élaborer au plus près des besoins des élèves. D’autant que dans les versions actuelles «[les professeur·es] réfléchissent et organisent [sa mise en oeuvre] collégialement» y compris en co-animation avec les personnels éducatifs, sociaux et de santé de l’Éducation nationale.
Le programme dans ses différentes versions, malgré des améliorations possibles, par exemple, pour que le terme de sexualité soit employé dès la maternelle, affiche un contenu progressiste tant dans ses objectifs que dans les termes employés: « [l’EAS] vise l’égalité de considération et de dignité, en particulier l’égalité entre les femmes et les hommes ; elle contribue à la lutte contre toutes les discriminations de sexe, d’identité de genre et d’orientation sexuelle (hétérosexualité, homosexualité, bisexualité, asexualité) ; elle sensibilise au principe du consentement et contribue à la prévention des différentes formes de violences (physiques, verbales, psychologiques, harcèlement, emprise), et notamment des violences sexistes et sexuelles (y compris l’inceste). L’éducation à la sexualité vise à construire une culture commune de l’égalité et du respect. Elle est renforcée par l’adoption d’une pédagogie égalitaire, collégialement assumée.»
C’est pourquoi il est impératif que ce programme soit enfin publié et qu’il soit accompagné le plus rapidement possible de formations nombreuses à destination de l’ensemble des enseignant·es (des 1er et 2nd degrés) mais aussi des CPE, des infirmièr·es et des assistant·es sociales. Du temps de travail dédié à la concertation des équipes pédagogiques et éducatives doit être prévu afin que les séances soient élaborées dans la collégialité. L’enjeu est grand: permettre à tou·tes d’accéder à une sexualité épanouie et à des relations saines.