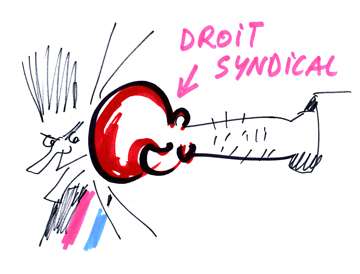L’adoption d’une stratégie juridique par une organisation syndicale ne va pas de soi ; elle procède des représentations du syndicalisme et du droit qui y prévalent. La tendance historique à l’institutionnalisation croissante de l’action et des organisations syndicales constitue une bonne clé de lecture, parmi d’autres, de ces stratégies.
[(
réflexions sur l’évolution de l’action juridique syndicale
)]
Philippe Enclos,
Maître de conférences en droit social (université Lille 2),
Secrétaire national au SNESUP-FSU, chargé des questions juridiques
Jusqu’au lendemain de la première guerre mondiale, le mouvement ouvrier et syndical français a, de manière générale, rejeté l’action juridique, en vertu d’une certaine analyse marxiste [[Notamment Evgueny B. PASUKANIS, La théorie générale du droit et le marxisme, précédé d’une analyse critique de Karl Korsch, Ed. EDI, 1970. Pour ce juriste soviétique, le « droit », distingué de la « norme » n’est, d’ailleurs, le produit que de la société bourgeoise. Lire aussi K. STOYANOVITCH, Marxisme et droit, préface de H. Batifol, LGDJ, 1964.
]] aux termes de laquelle, dans la société capitaliste, le droit, simple reflet des rapports de classes, est l’un des instruments majeurs par lesquels la bourgeoisie assoit sa domination sur la classe ouvrière : tout à la fois, il traduit et masque, au plan superstructurel, l’exploitation des salariés ainsi que la fonction dédiée des institutions politiques. Il serait donc vain de consacrer des forces à la tentative de modifier ce droit de classe, appelé à disparaître avec l’avènement de la dictature du prolétariat.
L’analyse est identique en ce qui concerne l’institution juridictionnelle : justice bourgeoise, justice de classe. Les conseils de prud’hommes, créés au début du XIX° siècle, constituent une exception notable à cette approche[[acques VILLEBRUN et Guy-Patrice QUÉTANT, Traité de la juridiction prud’homale, LGDJ, Paris, 1998
Pour une bibliographie quasiment exhaustive, voir cette page internet sur le [site du Maitron ->
http://biosoc.univ-paris1.fr/spip.php?article236]
]]. Si la CGT, notamment, se dote de commissions juridiques dès le début du XX° siècle, c’est surtout dans un but d’aide individuelle défensive à ses adhérents (renseignements, assistance devant les tribunaux), dans la tradition des sociétés de secours mutuel puis des bourses du travail, plutôt que dans le cadre d’une politique juridique revendicative. C’est, ensuite, la nécessité de former les conseillers prud’hommes salariés au droit du travail qui impulse l’ébauche de politiques juridiques au sein des confédérations (pour conserver l’exemple de la CGT : création de « Prudis », véritable centre de formation interne de conseillers prud’hommes, responsables syndicaux, représentants du personnel, « conseillers du salarié », défenseurs syndicaux, etc.). L’une des critiques récurrentes majeures de la droite contre le paritarisme dans les conseils de prud’hommes porte d’ailleurs sur la soi-disant incompétence juridique des conseillers prud’hommes.
Une loi du 12 mars 1920 octroyant aux syndicats la pleine capacité d’ester en justice, dont le principe avait été posé par la loi du 21 mars 1884, ouvrit une période nouvelle : cette même année, la CGT fonda sa revue « Droit ouvrier », puis, dès la fin des années 30, le SGEN incita ses militants à mener l’action juridique, et en 1951 la CFTC se dota d’un service juridique confédéral, etc. Cependant, on a pu observer que les syndicats n’utilisent pas pleinement la capacité d’ester en justice que la loi leur octroie[[Frédéric GUIOMARD, Syndicats : évolution et limites des stratégies collectives d’action juridique, Mouvements, n° 29, 2003/4
]]
++++
Au début des années 1950, le développement d’une législation de la négociation collective organisa la participation des travailleurs, par l’intermédiaire de leurs organisations représentatives, à l’élaboration des normes juridiques en matière de relations de travail.
En 1955, le professeur Marcel David créa à Strasbourg le premier Institut du Travail universitaire. Aujourd’hui au nombre de 11, ces instituts ont pour mission de former les responsables syndicaux, principalement en droit du travail, selon une méthode originale associant des enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs aux animateurs des structures syndicales internes de formation, dans un cadre législatif (le « congé de formation économique, sociale et syndicale » institué par les articles L 2145-1 et suivants du code du travail, avec financement par l’État). Très majoritairement animés par des juristes universitaires, ces instituts contribuent puissamment à élever le niveau de compétence juridique des responsables syndicaux, et fournissent un lieu exceptionnel pour la circulation des idées entre les mondes de la recherche scientifique et de l’action revendicative [[Lucie TANGUY, Les Instituts du travail. La formation syndicale à l’université de 1955 à nos jours. Presses universitaires de Rennes, 2006.
]].
Au cours des années 1970, la CFDT fut à la tête d’un mouvement de développement de stratégies juridiques et judiciaires : ralliant à cet effet le concours, notamment, du Syndicat des Avocats de France, du Syndicat de la Magistrature et de quelques universitaires sympathisants qui aidèrent à la théorisation d’une nouvelle doctrine dénommée « le conflit des logiques »[[Jean-Claude JAVILLIER, Une illustration du conflit des logiques, Droit social, 1976, p. 265 ; Alain SUPIOT, Le juge et le droit du travail, thèse, université Bordeaux I, 1979. Jean-Paul MURCIER, Le conflit des logiques. Le terrain des faits et celui du droit, Action Juridique CFDT, n° 11, 1979. Pour une analyse critique : Frédéric GEA, Contribution à la théorie de l’interprétation jurisprudentielle, droit du travail et théorie du droit dans la perspective du dialogisme, LGDJ, 2009.
]] (création de la revue « Action Juridique CFDT »). La grève générale de 1968 contribua fortement à la prise de conscience par les centrales syndicales de la nécessité de développer les luttes sur le terrain juridique [[Emeric TELLIER, Le droit comme outil de mobilisation et de syndicalisation (1968-1993), in IHS-CGT, « Propagande, information, communication. Cent ans d’expérience de la CGT, de 1895 à nos jours », CGT, Montreuil, 2009.
]].
Toutes les confédérations mirent en place ou développèrent notablement des services juridiques dans cette période, parfois même, faute de disposer de militants qualifiés, en recrutant des jeunes doctorants ou docteurs en droit, en s’assurant le concours d’avocats sympathisants, en s’appuyant sur les travaux scientifiques de professeurs d’université de gauche ou proches de la « doctrine sociale de l’Église »[[Jean-Charles DESCUBES, Renato Raffaele MARTINO, Angelo SODANO, Compendium de la Doctrine sociale de l’Église. Conseil Pontifical Justice et Paix. Cerf. [Sur le web->
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_fr.html]
]], en développant la formation juridique de leurs militants.
Il commençait de s’agir de mener de véritables luttes sur le terrain même du droit, visant à le transformer dans un sens favorable aux intérêts des salariés, d’exporter les conflits du travail dans le champ juridique institutionnel, tantôt en complément, mais tantôt aussi en palliatif aux luttes d’entreprises, à l’action revendicative. Cette stratégie s’efforce, principalement, de peser sur la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, afin de forcer des transformations du droit par le biais de son interprétation juridictionnelle.
Cette stratégie fut largement payante jusqu’au milieu des années 1980 : la chambre sociale de la Cour de cassation, enfin sensibilisée, rendit de nombreuses décisions de principe favorables aux intérêts des salariés, parfois même sans hésiter à faire dire à la loi ce qu’elle ne disait pas ou à combler des lacunes législatives dans le but explicite d’inciter le législateur à corriger sa copie[[Parmi une abondante littérature scientifique : Pierre CAM, Juges rouges et droit du travail, Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n° 19/1978, p. 8 et s. Jean PELISSIER, Antoine LYON-CAEN, Antoine JAMMEAUD, Emmanuel DOCKES, Les grands arrêts de droit du travail, préface de Gérard Lyon-Caen, Dalloz, 2004.
]].
Bien sûr, une telle politique jurisprudentielle n’aurait pas été possible sans une sympathie manifeste envers la cause ouvrière de nombre de conseillers, notamment de présidents, de la chambre sociale. La sociologie juridique trouverait là un vaste champ d’investigation.
++++
Depuis le début des années 90, et particulièrement du lancement par le MEDEF des « chantiers de refondation sociale », la situation a, de nouveau, considérablement changé : organisations syndicales et patronales se sont accordées pour revendiquer auprès de l’État, avec succès, une certaine autonomie normative. Une sorte de convention sociale stipule désormais que, dans un certain nombre de domaines relatif aux « garanties sociales », la loi doit être pré-négociée entre les « partenaires sociaux ». Cette représentation du processus normatif, initialement formée dans le domaine du droit de la formation professionnelle continue, s’étend aujourd’hui à un nombre croissant de thématiques.
La plupart des organisations syndicales se considèrent explicitement comme « acteurs de la loi », « créatrices de normes » et sont, généralement, désireuses d’être au moins consultées avant l’adoption des lois et décrets entrant dans le champ d’intervention qu’elles s’attribuent, indépendamment même de la saisine des instances consultatives où elles sont représentées. C’est ce qu’on appelle la « concertation sociale ».
L’apparition et le succès, durant les années 1990, de nouvelles organisations syndicales (le G10 devenu Solidaires !, la FSU et l’UNSA issues de la scission de la FEN, ainsi que plusieurs autres petits syndicats indépendants), marquent, selon le point de vue, tantôt une aggravation de l’éclatement du syndicalisme, tantôt un accroissement du pluralisme syndical. Sans doute en raison de leur jeunesse, ces organisations ne se sont pas encore dotées de véritables services juridiques fédéraux, bien que certains de leurs syndicats affiliés aient acquis une solide expérience juridictionnelle et disposent d’un service juridique national. Elles ont néanmoins développé une activité juridictionnelle parfois intense, particulièrement pour obtenir reconnaissance de leur représentativité puisqu’elles ne bénéficiaient pas de la présomption irréfragable de représentativité réservée administrativement depuis le début des années 1950, puis réglementairement en 1966, aux 5 confédérations traditionnelles. Ce fut surtout le cas de Solidaires ! et de syndicats SUD, qui, au tournant du XXI° siècle, ont remporté à cet égard quelques beaux succès devant la Cour de cassation et le Conseil d’État.
En tous les cas, ce phénomène a provoqué notamment, une vingtaine d’années plus tard, une très importante réforme du droit de la représentativité syndicale à laquelle les plus grandes confédérations ont activement contribué, en « concertation » avec un gouvernement dont, paradoxalement, elles dénoncent la politique de destruction systématique des acquis sociaux obtenus depuis la Libération…
La première décennie du XXI° siècle est caractérisée par une nouvelle évolution de ce processus séculaire. Le succès rencontré par cette approche nouvelle du « dialogue social » se manifeste de manière spectaculaire dans les protocoles adoptés par le Sénat (16 décembre 2009) et l’Assemblée nationale (16 février 2010) de « consultation des partenaires sociaux sur les propositions de lois relatives aux relations individuelles et collectives du travail, à l’emploi et à la formation professionnelle ». Certes, il ne s’agit que des propositions de lois, lesquelles émanent des parlementaires, et non des projets de lois, qui proviennent du gouvernement.
Dans le même temps, la « position commune » qui a conduit à l’adoption consensuelle de la loi du 20 août 2008 relative à la « modernisation du dialogue social » dans le secteur privé, ainsi que les « accords de Bercy » qui ont préparé le vote de la loi du 5 juillet 2010 relative à la « rénovation du dialogue social dans la fonction publique » constituent incontestablement une importante nouvelle étape de l’institutionnalisation des organisations syndicales et de la contractualisation des relations professionnelles.
++++
Fondamentalement, la question de l’action syndicale dans le champ juridique renvoie à la définition même du syndicalisme : pour cette raison, elle continue de faire débat. Très schématiquement, et au risque de la caricature, on distingue deux grands courants.
L’héritage anarcho-syndicaliste et celui du « syndicalisme révolutionnaire » inspiré par le marxisme tendent, aujourd’hui encore, à faire prévaloir un syndicalisme anticapitaliste, de lutte de classe, révolutionnaire ; le succès de Solidaires ! et le renouveau de la CNT en témoignent. Très récemment, on a pu noter la résurgence du syndicalisme de lutte de classe dans la bataille contre la réforme des retraites de l’automne 2010.
Dans cette optique, les institutions juridiques et étatiques, superstructure du système économique d’extorsion de la plus-value, constituent une cible pour le mouvement ouvrier qui tend à renverser le capitalisme. La législation ouvrière, à commencer par la loi Waldeck-Rousseau de 1884, et, plus tard, le code du travail, sont perçus non comme fixant les acquis des luttes, mais comme autant d’instruments d’embrigadement de la classe ouvrière et de ses organisations. L’arme suprême de la classe ouvrière est la grève générale illimitée[[Aristide BRIAND, La grève générale et la révolution, Le Havre, édition à bon marché, 1899. Robert BRECY, La grève générale en France, éd. EDI, 1969. Stéphane SIROT, La grève en France, une histoire sociale, XIX° et XX° siècles, éd. Odile Jacob, 2002.
]], l’action syndicale est, en tant que de besoin, illégaliste. Jamais définitivement acquis, les droits des salariés sont inscrits dans la réalité quotidienne des relations de travail plutôt que dans des codes ; sans cesse remis en cause par le patronat, leur respect exige une lutte permanente sur lieux mêmes de l’exploitation. Le conflit est le seul moteur des relations professionnelles, les lieux de production sont le terrain quasiment exclusif de la lutte de classes.
A l’opposé, le syndicalisme réformiste, convaincu de la possibilité d’améliorer le sort des salariés à l’intérieur même du système capitaliste, investit les institutions, se présente comme un acteur normatif légitime et compétent, prône la « concertation sociale » et la négociation collective comme formes principales de l’action syndicale. On ne recourt à la grève qu’en dernière extrémité, lorsque la négociation (à froid) a échoué. Le droit du travail, perçu comme protecteur et progressiste, ou au moins « ambivalent », enregistrant les concessions faites par le patronat, doit être défendu et amélioré. Le syndicat a vocation à intervenir dans de nombreux domaines de la vie sociale, à siéger dans de multiples instances sociopolitiques, bien au-delà du champ traditionnellement réservé au paritarisme (sécurité sociale, formation continue). Plus le syndicat s’institutionnalise, moins il recourt au conflit, plus il tend à valoriser l’action juridique à ses différents niveaux.
Cette présentation, ainsi réduite à une dichotomie abstraite, du schéma traditionnel ne rend naturellement pas compte de sa grande complexité. En particulier, elle ne permet de rendre compte de la diversité ni des moyens d’action[[Laurent WILLEMEZ, Droit du travail en danger. Une ressource collective pour des combats individuels, Edition du Croquant, 2006.
]], ni des objets de l’action et des politiques juridiques syndicales, lesquelles se déploient de plus en plus bien au-delà de la seule défense immédiate des stricts intérêts individuels et collectifs des salariés. Il n’est plus inhabituel, par exemple, que les organisations syndicales se lancent dans des batailles, parfois juridictionnelles, pour la défense plus générale des droits et libertés.
On peut, toutefois, faire l’hypothèse que la conception réformiste de l’action juridique syndicale a gagné beaucoup de terrain au cours des dernières décennies. C’est, clairement, à rapporter à l’évolution des orientations générales des confédérations considérées (ou se présentant comme) anticapitalistes. A titre d’illustration de cette évolution, on se contentera de pointer certains débats du 49ième congrès de la CGT (décembre 2009), où la direction sortante s’est trouvée en butte à un grief de virage réformiste, minoritaire mais retentissant.
La tenue, les 11 et 12 mai 2011 à Montreuil, d’un colloque sur « Les pratiques syndicales du droit en France aux XX° et XXI° siècles », organisé par le Centre d’Histoire Sociale du XX° siècle (CNRS et université Paris 1) et l’Institut d’Histoire Syndicale de la CGT devrait fournir une occasion de dépoussiérer les représentations reçues et d’en finir avec les raccourcis réducteurs dont ces quelques lignes ne parviennent pas à se libérer…