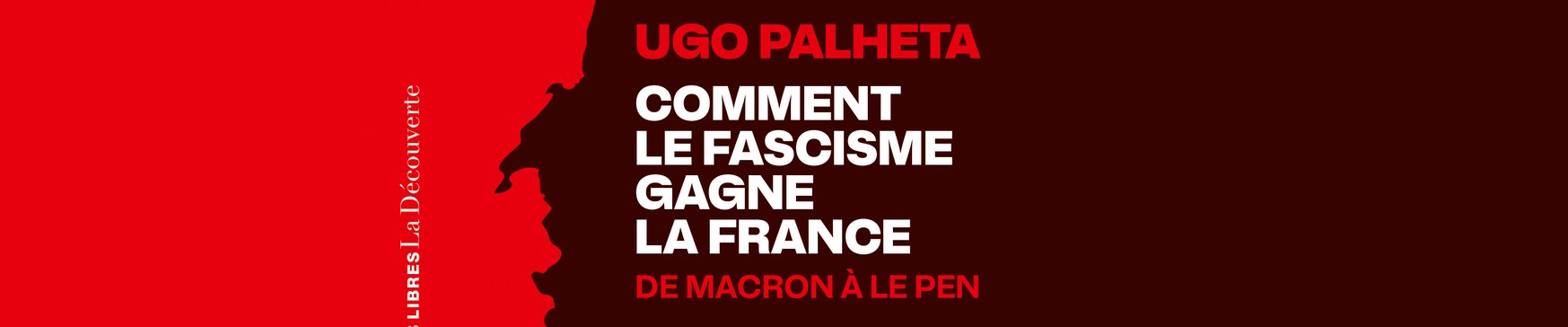Ugo Palheta vient de publierComment le fascisme gagne la France, version remaniée et augmentée dela Possibilité du fascisme, paru en 2018. Il y note une progression des thèses racistes et xénophobes, tout en réfutant l’inéluctabilité du fascisme.
L’histoire se répète-t-elle? Peut-on comparer les années 1930 et 1940 et notre époque ?
On a l’habitude de dire que comparaison n’est pas raison. S’il s’agit simplement de rappeler qu’on ne peut pas assimiler une situation historique à une autre, cela relève de l’évidence. Mais l’effort permanent de contextualisation, de mise en évidence des caractères singuliers de chaque situation historique, ne doit pas nous conduire à renoncer à apprendre du passé. Certains traits de notre conjoncture font qu’elle est comparable à celle des années 1930 et permettent de comprendre la fascisation en cours, en particulier le mixte de stagnation économique et d’instabilité hégémonique (qui renvoiein fineà la crise du capitalisme).
D’autres permettent de comprendre la spécificité de notre situation : outre le basculement climatique, plus de quatre décennies de néolibéralisme et d’affaiblissement des mouvements ouvriers ont produit des formes de dépolitisation, de démobilisation et de « passivisation » de larges pans des classes populaires. Cela n’exclut pas des explosions sociales, mais le niveau général d’organisation des travailleur·ses est historiquement faible. Cela explique pourquoi la dimension de violence paramilitaire est plus faible dans le néofascisme que dans le fascisme « classique », sans que le projet fasciste – d’une renaissance nationale/civilisationnelle/raciale par épuration – ait disparu.
Quelle différence ou au contraire collusion entre l’étatisme autoritaire de Macron/Darmanin/Retailleau et le projet fasciste de Le Pen et Bardella ?
Il ne faut pas penser cela en termes de différences doctrinales ou idéologiques, comme le ferait une histoire des idées (qu’elle cherche à montrer les divergences ou les convergences). Même si, sur le papier, les projets et objectifs des droites libérales, conservatrices et fascistes sont différents, on sait que ces familles politiques ont convergé dans des situations historiques spécifiques, par exemple dans les années 1930. Et pas simplement parce qu’il s’agissait de faire face à une révolution ouvrière imminente, mais parce que cela correspondait
aux intérêts de fractions importantes et identifiables de la classe capitaliste, mais aussi aux stratégies de certains acteurs majeurs du champ politique. C’est ce qu’on observe depuis quelques années, dans la conjoncture de polycrises du capitalisme (limites environnementales en passe d’être atteintes, stagnation économique, instabilité politique, etc.)
Penses-tu toujours qu’à gauche on minimise le péril ?
C’est moins le cas aujourd’hui, car à présent cela crève les yeux : non seulement les extrêmes droites progressent partout dans le monde, y compris dans des pays où elles étaient inexistantes électoralement il y a quinze ans (Allemagne, Espagne, Portugal, pour l’Europe), mais aussi car elles sont souvent engagées dans des processus de radicalisation, et non pas de notabilisation. Des phénomènes comme le trumpisme, le bolsonarisme ou le mileisme vont dans le sens d’une fascisation de larges pans des droites traditionnelles. Deux processus se mêlent : mainstreamisation du fascisme (par pénétration et banalisation de ses idées dans les champs politique et médiatique), et fascisation dumainstream. Cela s’opère essentiellement à travers la tentative d’acteurs issus de la droite de regagner le terrain perdu au profit de l’extrême droite traditionnelle, Zemmour et Retailleau ou Darmanin étant les incarnations françaises de cette tendance. La gauche reconnaît à présent généralement le danger, mais personne n’est parvenu pour l’instant à résoudre le problème stratégique. Les vestiges de la social-démocratie poursuivent partout ou presque leur trajectoire d’accompagnement du néolibéralisme et les gauches radicales (ou du moins anti-néolibérales) ne parviennent pas à percer et à conquérir durablement de larges pans des classes populaires, des minorités et de la jeunesse, la France insoumise étant un des rares exemples en ce sens.
Faut-il considérer la progression de l’extrême droite comme inéluctable ? Peut-on encore infléchir cette dynamique ?
Qu’il y ait une tendance à la montée des extrêmes droites, c’est évident. L’une des grandes difficultés pour notre camp, pour la gauche de rupture et d’émancipation, c’est l’affaiblissement des mouvements ouvriers qui ne permet pas d’obtenir des victoires sociales majeures, c’est-à-dire d’acculer les bourgeoisies à des concessions. Mais une tendance n’est pas inéluctable, et d’une certaine manière la montée des extrêmes droites est elle-même une réaction à la progression de mouvements – féministes, LGBTQI+, antiracistes – et d’idées égalitaires au cours des dernières décennies. Des résistances existent partout et même l’arrivée au pouvoir des extrêmes droites n’est pas la fin de l’histoire. Aux États-Unis et au Brésil, quand Trump et Bolsonaro sont parvenus au pouvoir, ils n’ont pas pu aller au bout de leur projet, briser les mouvements populaires et bâtir un État policier de type fasciste.
Quid de la dimension internationale de cette dynamique néofasciste?
Même dans l’entre-deux-guerres, jamais on n’a observé une telle progression mondiale de l’extrême droite. Il n’y a pas d’instance de coordination de l’Internationale néofasciste et les extrêmes droites sont diverses (sur les plans stratégique, programmatique, idéologique ou organisationnel), notamment dans la mesure où elles doivent – et savent – s’adapter aux coordonnées politiques nationales. Reste qu’on peut identifier des pôles hégémoniques ou aspirant à l’hégémonie (parfois concurrents, entre Trump et Poutine par exemple), des réseaux mondiaux visant à intensifier la diffusion des idées réactionnaires (notamment dans les sphères libertarienne-autoritaire, avec le réseau Atlas, ou dans les sphères intégriste ou identitaire), des emprunts et des hybridations idéologiques ou stratégiques, des appuis financiers ou politiques entre forces installées et forces émergentes, etc.
Comment développer un antifascisme conséquent ?
Cela commence par la reconnaissance du danger mais aussi de notre capacité collective à conjurer le désastre. Donc cela suppose de défaire le double récit de la normalisation de l’extrême droite et de sa victoire inéluctable. Mais tout ne se passe pas sur le terrain du « narratif » comme on dit souvent aujourd’hui. Il nous faut à la fois une pratique collective de l’autodéfense, face aux violences d’extrême droite et à la fascisation de l’État, mais aussi une stratégie partagée, dont un élément central est la nécessité d’une rupture avec les politiques néolibérales, productivistes et racistes. Toute expérience de construction d’un socialisme du XXIe siècle commencera par là, et supposera pour avancer aussi bien des mobilisations de masse que des victoires électorales. Mais une stratégie n’est qu’un mot en l’air si on ne pose pas le problème de sa base matérielle, c’est-à-dire ici du renforcement des infrastructures de la résistance, donc de l’accroissement du niveau d’organisation et de coordination des exploité·es et des opprimé·es : bien sûr les contre-pouvoirs syndicaux et partis de gauche radicale, mais aussi les collectifs antiracistes, féministes, antifascistes, écolos radicaux, etc., ou encore les médias indépendants. C’est à construire ce bloc, comme on a commencé à le faire en juin-juillet 2024, que l’on doit travailler ardemment.
*PROPOS RECUEILLIS PARSOPHIE ZAFARI