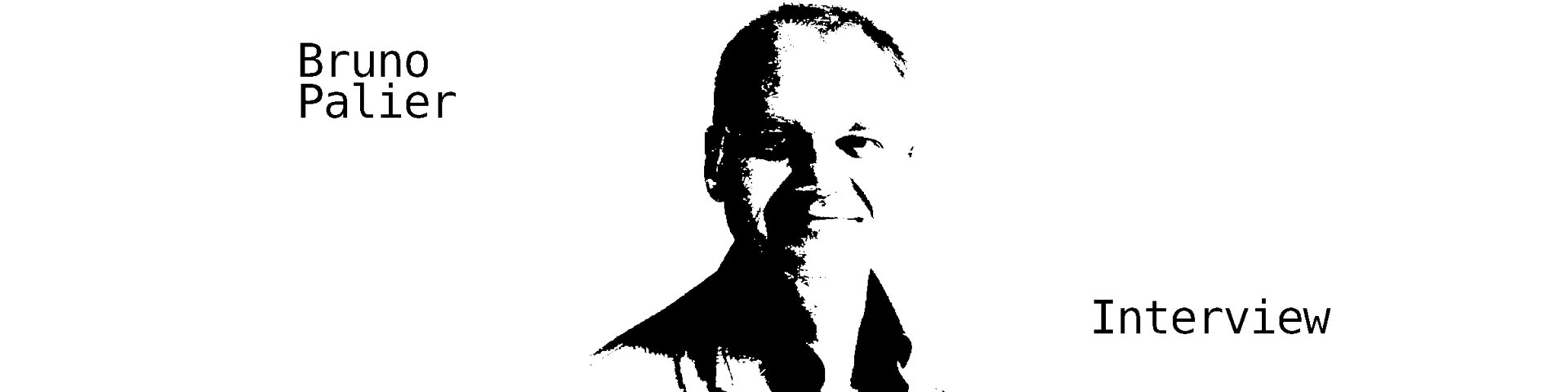Bruno Palier est directeur de recherche du CNRS à Sciences Po Auteur de l’étude du CeseLa stratégie d’investissement social, co-auteur avec Clément Carbonnier deLes femmes, les jeunes et les enfants d’abord, investissement social et économie de la qualité,PUF, 2021 et coordinateur de nombreux ouvrages dont :Travailler mieux(avec Christine Erhel), Paris, PUF, 2025 etQue sait-on du travail ?, Paris, Presses de sciences Po, 2023.
Pour Bruno Palier, il est urgent de créer de nouveaux droits pour une protection sociale efficace. Ils pourraient être financés notamment par la suppression d’exonérations fiscales coûteuses.
Quels ont été les principaux apports du système de protection sociale mis en place à l’issue de la Seconde Guerre mondiale?
Depuis la fin du XIXe siècle, de nombreux·ses salarié·es, surtout les ouvrièr∙es, étaient confronté∙es à des risques sociaux, c’est-à-dire ne plus pouvoir travailler, en raison d’une maladie, d’un accident ou de l’âge, et donc de ne plus avoir de revenus pour vivre. Pour y répondre, des assurances sociales ont été instaurées progressivement pour être généralisées en 1945 : chacun cotise et, en cas de maladie, vieillesse, accident, perçoit un revenu de remplacement. Elles ont apporté une grande sécurité face à la peur du lendemain, réduit la pauvreté, l’accès à la santé a permis d’allonger l’espérance de vie, de baisser la mortalité infantile.
80 ans plus tard, ce modèle est-il une protection encore efficace pour la population?
Notre protection sociale reste très performante, surtout pour les retraites, parmi les plus généreuses d’Europe, et l’espérance de vie augmente. Mais le système ne répond pas aux nouveaux risques sociaux qui vont de pair avec les évolutions économiques et sociales.
D’abord, les familles. Le modèle des années 1940-1950 a laissé place à de nombreuses familles monoparentales, à 80 % des femmes seules avec enfants, très exposées à la pauvreté, faute d’aides adaptées : assistance financière faible et garde d’enfants nécessaire aux femmes pour pouvoir travailler.
Ensuite, les jeunes. Leur transition vers l’âge adulte est plus lonque et plus difficile aujourd’hui (études, logement et recherche d’emploi). Faute de soutien direct, ils et elles restent dépendant·es de parents, parfois pauvres, ce qui entretient la reproduction de la pauvreté.
Troisième risque, la dépendance. Une branche spécifique de la Sécu a été créée mais n’est pas assez financée. De plus. la dépendance requiert des services (maintien à domicile, établissements spécialisés) actuellement insuffisants, faisant peser la charge de l’aide sur les femmes de la famille au détriment de leur carrière.
Quatrième enjeu, les femmes. Bien qu’incitées à travailler, elles n’ont pas les carrières ni les salaires des hommes (ce qui les désavantage pendant leur vie active mais aussi pendant la retraite). Elles sont concentrées dans des secteurs de service aux autres, de soins, d’aide à domicile, dans la santé, dans l’éducation… essentiels mais moins bien rémunérés (les femmes sont plus au Smic que les hommes), plus à temps partiel (près de 20 % des salarié·es en France sont à temps partiel, 80 % sont des femmes), plus sur des horaires atypiques rendant difficile la conciliation entre vies professionnelle et familiale.
Enfin, les qualifications : le droit à la réussite scolaire pour toutes et tous. Aujourd’hui, les peu diplômé∙es connaissent un chômage quatre fois plus élevé que les bac +3. Or, l’accès à la qualification n’est pas, en France, un droit pour toutes et tous mais est favorisé pour celles et ceux qu’on estime comme étant les meilleur·es. Cet élitisme est socialement injuste et économiquement inefficace, car l’économie repose aujourd’hui sur une main-d’œuvre qualifiée pour fonctionner correctement.
Pouvez-vous expliquer la différence entre l’investissement social1et notre système basé sur des assurances sociales ?
Les assurances sociales attendent que le risque soit advenu pour soutenir les individus. À l’inverse, l’investissement social intervient en amont. Il essaye d’être dans la prévention. Il y a donc une différence de temporalité mais aussi de modalité d’intervention : les assurances sociales versent de l’argent une fois le risque advenu alors que l’investissement social repose beaucoup plus sur des services (école, formation, accompagnement, aide à domicile, prise en charge de personnes handicapées ou dépendantes…).
Quels seraient selon vous les droits nouveaux à mettre en œuvre en priorité ?
Le premier droit serait celui de la réussite scolaire pour toutes et tous, à l’opposé de la conception française où l’on suppose que l’enfant a ou non du talent. Inspirons-nous du modèle finlandais : former les enseignant·es à la pédagogie, aux différentes méthodes d’apprentissage et au développement de l’enfant, afin que chacun·e acquière les savoirs nécessaires.
Le deuxième serait un droit à revenu pour tous les jeunes dès 16 ou 18 ans, afin de réduire leur dépendance aux parents.
Troisième droit : le droit à une carrière complète pour les femmes ce qui implique davantage de places en crèche, avec une priorité pour les mères seules.
En quatrième, un véritable droit à la formation pour toutes et tous. Le compte personnel de formation est insuffisant : aujourd’hui, les plus diplômé·es accèdent davantage à la formation, et de fortes inégalités existent entre salarié·es de
grandes entreprises, petites entreprises, indépendant·es, auto-entreprises.
Enfin, l’accès aux services essentiels doit être garanti (transports collectifs, logement de qualité et bien isolé, énergie propre et abordable…)2
Comment financer ces investissements sociaux ?
Il est tout à fait possible de financer ces investissements en supprimant les nombreuses dépenses publiques inefficaces, parmi elles, une partie des exonérations de cotisations sociales (80 Mds) qui n’ont pas atteint les objectifs fixés (stimuler les création d’emplois et les exportations). Il y a aussi les 200 Mds d’aides aux entreprises aujourd’hui non conditionnées. L’enjeu n’est pas tant de les supprimer mais de les conditionner à l’investissement avec des objectifs environnementaux et de qualité de l’emploi pour favoriser une montée en gamme de l’économie française3 .
Autre mesure, taxer les riches au même niveau que les autres ménages. Gabriel Zucman montre que les ultra-milliardaires contribuent bien moins que le reste de la population et les retraité·es aisé·es payent moins d’impôts que les actif·ves aisé·es.
Enfin, l’endettement peut être un levier pour financer des investissements, puisqu’ils offrent un retour durable, contrairement à la dette actuelle tournée vers la consommation, qui entretient la croissance sans répondre aux enjeux sociaux et environnementaux de long terme.
Quels exemples à l’international pourraient inspirer la France ?
On peut citer les systèmes nordiques où les retraites pèsent moins dans les dépenses sociales car les gens travaillent plus longtemps grâce à la formation et à de meilleures conditions de travail.
L’Allemagne, avec un coût du travail comparable à la France, exporte plus en misant sur la qualité (voitures, chimie…), ce qui suppose de l’investissement dans les qualifications, la protection et la qualité des conditions de travail des salarié·es.
L’Espagne constitue un autre exemple intéressant. Malgré les difficultés, elle développe des politiques d’investissement social : droits liés aux risques environnementaux, égalité femmes-hommes, soutien aux enfants et aux jeunes. La Commission européenne constate que cela fonctionne et que le pays s’en sort de mieux en mieux.
Ainsi, le modèle n’est pas uniquement celui du déclin et du chaos que nous présentent les gouvernements français actuels, mais pourrait être celui du progrès social fondé sur cet esprit d’investissement social.
PROPOS RECUEILLIS PAR É.M.
NOTES :
- Clément Carbonnier et Bruno Palier,Les femmes, les jeunes et les enfants d’abord, investissement social et économie de la qualité,PUF, 2022.
2.Refonder le système de protection sociale. Pour une nouvelle génération de droits sociaux, Hélène Périvier, Bernard Gazier et Bruno Palier.
3.Cf. Du low cost à la qualité pour toutes et tous, une nouvelle stratégie de prospérité pour la France,par Bruno Palier, inTravailler mieux, ouvrage dirigé par Christine Erhel et Bruno Palier, PUF, 2025.