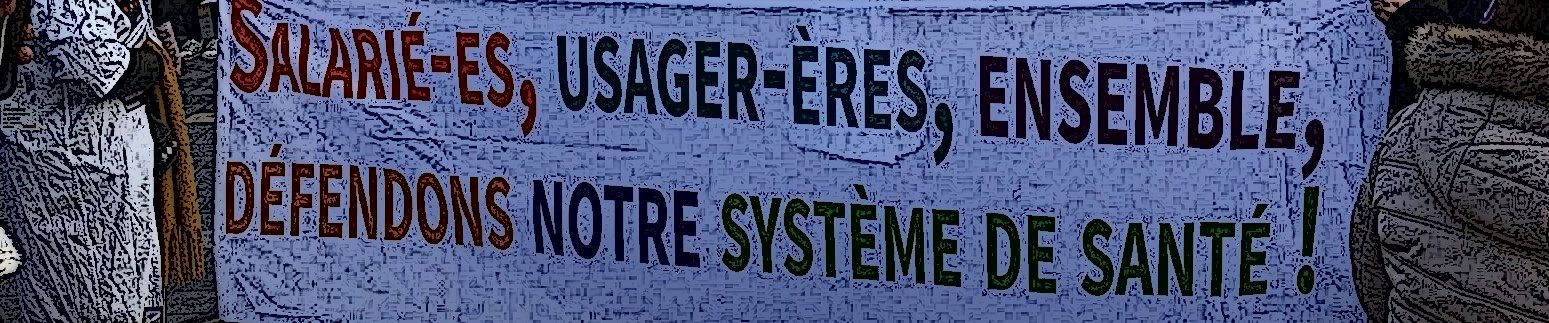PAR ANDRÉ GRIMALDI, professeur de médecine émérite — CHU Pitié Salpêtrière — et militant pour la défense de l’hôpital public, son analyse des politiques à l’œuvre dans le secteur de la santé.
Le désengagement récurrent de l’État dans la protection sociale a laissé la place à des officines privées dont le but n’est pas la santé publique, mais la réalisation de bénéfices sur le dos des citoyen·nes.
Le rapport annuel « Charges et produits pour 2026 » de la Sécurité sociale s’inquiète de « l’accélération de la financiarisation de l’offre de soins ». La financiarisation y est définie comme « un processus par lequel des acteurs financiers non directement professionnels de santé investissent dans des structures de soins avec comme finalité première de rémunérer le capital investi dans une logique de court terme ». Ce processus se développe depuis plusieurs années par le rachat, par des groupes adossés à des fonds d’investissements, de structures de soins qui appartenaient auparavant à des professionnels libéraux, à l’occasion de leur départ en retraite ou en raison de difficultés financières. Les moyens financiers mobilisés par les fonds et les banques permettent les investissements importants nécessaires pour l’acquisition de nouveaux équipements onéreux (appareils d’imagerie, automates d’analyses médicales, robots, matériel informatique…), la modernisation des locaux, le respect de normes de qualité, le souhait des professionnels de santé de se décharger de la gestion devenue complexe, le recrutement concurrentiel de professionnels dans un contexte de manque de médecins et d’augmentation des besoins de la population.
Cet attrait des fonds d’investissements pour la santé s’explique d’une part par le souhait des gouvernements néolibéraux (de droite comme de gauche) de réduire les investissements de l’État dans les services publics pour les transférer au privé et d’autre part par la solvabilité garantie de la demande en santé.
Cette financiarisation concerne l’industrie pharmaceutique, qui en est pour ainsi dire le modèle, mais aussi la biologie où six groupes internationaux privés contrôlent plus de 60 % du marché, ou la chirurgie où quatre chaînes de cliniques possèdent plus de 40 % de la chirurgie privée¹. Suivent la radiologie, la pharmacie, les centres de santé d’ophtalmologie et d’optique, de dentisterie et maintenant de soins primaires. Ces centres de soins primaires cherchent à répondre (et à profiter) des faiblesses de notre système de santé. Ainsi pour « aider à la permanence des soins en ville » et « soulager les urgences hospitalières » se développent des centres de soins sans rendez-vous (et sans suivi des patient-es) : Elsan et Ramsay souhaitent créer des centres de santé de soins primaires assurant le premier recours tandis que leurs cliniques assureraient le second recours spécialisé. Il est significatif que Ramsay ait cherché à racheter les centres de santé de la Croix rouge et qu’Elsan soit candidat au rachat de l’institut mutualiste Montsouris : ces établissements privés à but non lucratif financièrement fragilisés sont en effet des proies pour les groupes privés à but lucratif.
Le pouvoir des manageurs
Pour assurer leur rentabilité, ces groupes financiarisés utilisent différents movens :
- choisir les activités rentables (comme la chirurgie ambulatoire);
- sélectionner les patient·es qui ont les moyens de payer directement de leur poche ou grâce à leur « bonne complémentaire » les dépassements d’honoraires, la chambre seule et toute demande hôtelière supplémentaire ;
- dégrader la qualité des soins, et surtout réaliser des actes injustifiés mais rentables (cf. la plainte de l’association Renaloo contre la clinique Elsan de Nancy pour dialyses rénales abusives ou la multiplication d’actes inutiles dans les centres dentaires ou d’ophtalmologie);
- surcoder l’activité afin d’augmenter la facture adressée à la Sécu voire recourir à la fraude (l’Assurance maladie a déconventionné dix centres de santé dentaires du réseau Nobel Santé et sept centres d’ophtalmologie Express).
Cela suppose que les « manageurs » aient pris le pouvoir sur les professionnel·les de santé embauché·es sous contrat individuel et qu’ils les aient exclu·es de la gouvernance.
L’optimisation de la rentabilité passe aussi par des fusions permettant des économies d’échelle, des restructurations abandonnant les activités jugées non rentables à moins
qu’elles servent de produit d’appel et par la mise en place d’une « modernisation managériale ». L’optimisation financière fait également appel à l’utilisation d’outils financiers comme la création de holdings, opacifiant les flux financiers, ou encore les montages juridiques complexes faisant intervenir des sociétés commerciales ou immobilières louant très cher
leurs services à la clinique délivrant les soins, bien que les actionnaires soient en réalité les mêmes. Ainsi les comptes de la clinique apparaissent à l’équilibre ou très faiblement bénéficiaires ou mieux encore en déficit (cf. le rapport de la CFDT sur Ramsay en janvier 2025 montrant que 245 millions d’euros ont été versés chaque année comme loyers immobiliers, soit plus de 4 fois le bénéfice du groupe depuis 2020).
Le service public oublié
Étonnamment, la direction de la Cnam², oubliant la règle éthique du service public de santé, « le juste soin pour le patient au moindre coût pour la collectivité », déclare que « son approche de la financiarisation n’est pas idéologique mais pragmatique en cohérence avec son rôle de régulateur ».
L’École émancipée a demandé à André Grimaldi, professeur de médecine émérite — CHU Pitié Salpêtrière — et militant pour la défense de l’hôpital public, son analyse des politiques à l’œuvre dans le secteur de la santé.
Comme si l’objectif de la financiarisation n’était pas de transformer les revenus publics en profits privés, en utilisant les multiples moyens de contourner ladite régulation : opacité des données, complexité des montages financiers, recours au droit européen des affaires. Ces entreprises financiarisées internationales peuvent cesser leur activité à tout moment si elles ne la jugent pas assez rentable ou grossir jusqu’à devenir too big to fail ayant alors les moyens d’imposer leur volonté à l’État. C’est ce qui s’est passé avec Big Pharma pour l’accès au vaccin lors de la pandémie de Covid 19 ou avec les laboratoires de biologie qui ont refusé en 2022 la taxe de 250 millions d’euros réclamée par le gouvernement après l’augmentation de leur chiffre d’affaire de plus de 6 milliards d’euros grâce à la réalisation des tests PCR pour le dépistage du SARS-CoV-2, ou encore en 2024 avec les cliniques privées menaçant d’une grève des soins si leurs tarifs de T2A3 n’étaient pas rehaussés au-delà de l’ajustement automatique prévu en rapport avec l’augmentation de leur volume d’activité. À chaque fois, le gouvernement a reculé.
Le rapport de la direction de la Sécu oublie de dénoncer l’autre financiarisation : celle des compagnies d’assurances participant à l’union des organismes complémentaires d’assurance maladie (Unocam), celle de la Sécu elle-même
finançant sa dette en empruntant sur les marchés depuis la création, par le plan Juppé, de la Cades4 en 1996 (la Sécu a remboursé depuis au secteur financier international 79 milliards d’euros d’intérêts) et celle des hôpitaux publics depuis 2000, fortement encouragés à s’endetter
sur les marchés financiers pour financer les plans santé 2007 et 2012. Leur dette est passée de 2010 à 2020 de 10 à 30 milliards d’euros (dont 10 ont été transférés par le gouvernement à la Cades).
La dette de l’APHP5 atteignait, en 2022, 3.5 milliards d’euros l’obligeant à rembourser chaque année 170 millions qui contribuent à son déficit chronique.
Cette financiarisation coûte cher aux citoyen·nes qui paient les cotisations et contributions à la Sécu et elle menace notre souveraineté. «Déléguer à d’autres notre capacité à soigner est une folie» déclarait en 2020 Emmanuel Macron dans un court moment de lucidité provoqué par la pandémie.
NOTES:
-
- Il s’agit d’Elsan détenu à 75 % par le fond CVC Capital Partners, de Ramsay détenu à 53 % par le groupe australien Ramsay Health Care et à 40 % par Prédica-Crédit agricole, de Vivalto détenu par la MACSF, Arkéa Capital, BNP Paribas, Crédit agricole, le fond Hay fin, IK Partners, BPI France, et Mubadada appartenant au gouvernement d’Abu Dhabi et d’Almaviva détenu à 60 % par un fond koweitien et à 16 % par BPI France.
-
- Caisse national d’assurance maladie.
-
- Tarification à l’acte.
-
- Caisse d’amortissement de la dette sociale.
-
- Assistance publique Hôpitaux de Paris.