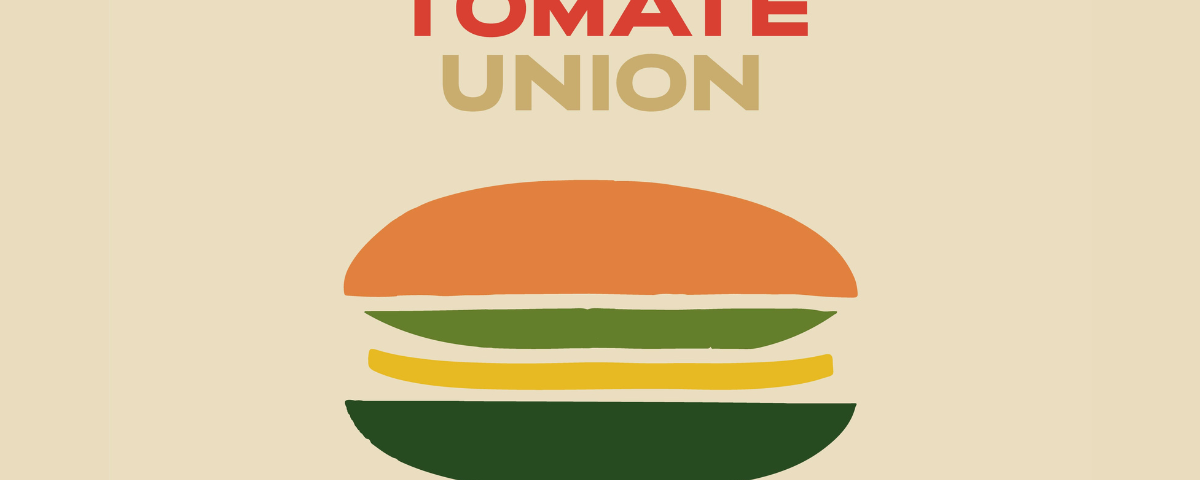PAR KAREL YON
Appel à tout bloquer le 10 septembre, question de confiance du Premier ministre le 8, appel syndical à la grève le 18, la rentrée se fait sur fond de crise. La responsabilité des syndicats dans la période est de faire le lien entre le social et le politique afin de ne pas laisser la route ouverte à l’extrême droite.
Grâce à la pétition lancée contre le projet de budget du gouvernement au cœur de l’été, l’unité intersyndicale a pu se reconstituer après le passage à vide lié aux désaccords face au « conclave » sur les retraites. Fin août, la réunion de l’intersyndicale a confirmé le retour de ce front uni en faisant du 18 septembre « une journée de mobilisation sur l’ensemble du territoire […], y compris par la grève et la manifestation1. » Si ces deux événements ont confirmé l’échec de la tentative cédétiste de renouer le dialogue social avec les gouvernements Barnier et Bayrou, ils ont aussi illustré la capacité des mobilisations enclenchées sur les réseaux sociaux à peser sur les stratégies syndicales. La pétition intersyndicale en ligne, lancée le 22 juillet, a en effet été inspirée par le succès fulgurant du texte demandant l’abrogation de la loi Duplomb qui, deux jours plus tôt, avait dépassé le million de signataires. Quant à l’appel intersyndical à se mobiliser le 18 septembre, il se positionnait non seulement face au Premier ministre qui venait d’annoncer un vote de confiance pour le 8 septembre mais aussi face à la montée en puissance de l’appel à « tout bloquer » dans le pays le 10 septembre.
Faute de consensus entre centrales sur le sujet, le communiqué intersyndical du 29 août s’est contenté d’une allusion au mouvement du 10 septembre, en évoquant la « colère » des travailleurs et travailleuses qui se manifeste par la « multiplication des mobilisations sous diverses formes ». Située à bonne distance, l’échéance intersyndicale du 18 septembre permet aux syndicats de transformation sociale qui ont choisi de relayer
le 10, en appelant ce jour-là à des assemblées générales ou à la grève sur les lieux de travail, de présenter ces dates comme deux étapes d’un processus de mobilisation citoyenne plus large, tout en permettant au mouvement syndical de se poser comme le débouché naturel de la contestation populaire.
Rentrée sociale incertaine
Cela étant dit, rien ne permet de garantir que la rentrée sociale soit aussi chaude que ne l’espèrent les organisateur·trices du 10 septembre. Que les réseaux sociaux numériques jouent désormais un rôle incontournable dans les processus protestataires ne signifie pas nécessairement qu’ils renforcent les dynamiques militantes. Certes, ils facilitent la mise en relation et la coordination de l’action d’individus et de groupes éloignés les uns des autres. Mais lorsqu’on en vient à l’action sur le terrain, à la construction de mobilisations durables et d’un sens partagé des événements, les infrastructures militantes continuent de jouer un rôle décisif. Or, celles-ci sont de plus en plus fragiles, à commencer par les organisations syndicales. On l’a vu avec le mouvement des retraites de 2023 : en dépit de tous les efforts militants pour étendre et généraliser les grèves, en dépit d’un appel intersyndical unanime à « mettre la France à l’arrêt », 2023 s’est moins joué sur les lieux de travail que dans la rue. Ce repli sur le registre manifestant accompagne une tendance lourde au déclin de la conflictualité gréviste. Celle-ci témoigne à la fois d’un affaiblissement de la présence militante sur les lieux de travail, d’une hostilité accrue des employeurs et des pouvoirs publics vis-à-vis de la protestation et, plus largement, de transformations sociales, économiques et juridiques qui fragmentent et déstabilisent les collectifs de travail, rendant la grève plus coûteuse et difficile. Le regain de syndicalisation constaté au moment du mouvement des retraites, et encore l’année suivante pendant la campagne législative, ne semble pas à ce stade avoir permis d’inverser la donne. Les syndicats éprouvent de grandes difficultés à accueillir et retenir des néosyndiqué·es dont les logiques d’engagement déstabilisent en outre parfois les habitudes militantes.
Un mouvement syndical divisé
À l’heure où ces lignes sont écrites, l’hypothèse d’un blocage effectif du pays le 10 peut donc sembler peu crédible, sans même parler du fait que certain·es en ont une compréhension très différente : quand les un·es pensent grève et manifestations, d’autres envisagent plutôt des démarches individuelles comme l’auto-confinement ou le refus de consommation. Cette incertitude sur la mobilisation sociale est renforcée par l’incertitude sur le terrain de la politique institutionnelle, après l’annonce d’une démission programmée du gouvernement Bayrou. C’est une autre caractéristique dont le mouvement syndical doit prendre la mesure : nous sommes dans une période de crise qui se caractérise par l’interdépendance renforcée entre ce qui se joue sur les terrains social et politique. Cette situation vient de loin. Sans même parler des dimensions géopolitiques et environnementales qui la surdéterminent, la radicalisation des politiques néolibérales, dont le budget austéritaire de Bayrou est le dernier avatar, sape la base sociale déjà fragile du macronisme et déstabilise toujours plus les classes populaires. Tandis que la violence de l’offensive contre le monde du travail relativise les différences entre syndicats, l’instabilité politique favorise l’extrême droite devenue une option légitime au sein des élites.
Alors même que le patronat organisé n’entend faire aucune concession et cherche au contraire à pousser son avantage politique, comme l’a illustré la mise en scène du « Front économique » lors des universités d’été du Medef, le mouvement syndical reste à la fois divisé et indécis. Comme l’a tristement rappelé pendant l’été l’épisode de militant·es CGT chassé·es d’un meeting parce qu’ils et elles dénonçaient la présence du député RN de la circonscription2, une partie du mouvement syndical (FO, CGC, CFTC) a renoncé à la mobilisation antifasciste. On l’avait déjà vu en 2024 : la dissolution de l’Assemblée nationale ayant ouvert la possibilité concrète d’une victoire politique de l’extrême droite, une majorité de syndicats, de Solidaires à l’Unsa, ont appelé à lui faire barrage et se sont engagés plus ou moins ouvertement en faveur du Nouveau Front populaire. Au nom de la séparation du social et du politique, FO, CGC et CFTC sont restées au bord du chemin. Dans le même temps, une fraction centriste, autour de la CFDT et de l’Unsa, est résolue à s’opposer à l’extrême droite et, de plus en plus, aux politiques néolibérales qui la renforcent, mais renâcle à mettre cette opposition au service d’autre chose que la réhabilitation d’une alternative sociale-démocrate. Or, un tel pari est voué à l’échec, car dans un contexte global de radicalisation néolibérale, les bases sociales de la démocratie sociale n’existent plus. C’est ce qu’a illustré le pari raté, tenté en parallèle sur les terrains syndical et politique, de la participation cédétiste au « conclave » sur les retraites et de l’abstention socialiste face au gouvernement Bayrou. Quant au syndicalisme de transformation sociale (FSU, CGT, Solidaires), sa fragmentation organisationnelle l’empêche de reconquérir une position de leadership. Sans compter le fait que la Charte d’Amiens continue d’y être agitée, parfois sincèrement, parfois pour des raisons de basse politique interne, pour dissuader le syndicalisme de s’engager dans la refondation d’une alternative politique démocratique, sociale et écologique.
Une crise qui s’approfondit
La montée en puissance de la date du 10 septembre, l’annonce surprise du vote de confiance le 8 septembre qui ravive la menace d’une arrivée du RN au pouvoir, témoignent de la volatilité de la période. S’il est impossible de prédire à quel niveau s’élèvera le thermomètre de la rentrée sociale, il est certain que la crise sociale et politique est appelée à s’approfondir. Les organisations syndicales doivent prendre la mesure de ce nouveau contexte. Seule une échappée du syndicalisme au-delà de la sphère routinisée de la démocratie sociale peut ouvrir une alternative progressiste à la victoire annoncée de l’extrême droite. L’heure n’est plus à opposer le social au politique ; toute la période récente témoigne de leur dialectique incessante. La force du mouvement syndical consiste précisément dans sa position à la jonction de ces deux univers : comme un élément incontournable de la construction d’un rapport de forces sur le terrain social, comme un opérateur décisif de la traduction des revendications sociales en programme politique, et comme un aiguillon unitaire face à la division dramatique des partis de gauche.
NOTE :
- « Les sacrifices pour le monde du travail, ça suffit ! », communiqué intersyndical, 29 août 2025.
- Bas-Rhin : Force ouvrière invite le RN, la CGT s’y oppose et se fait virer,Blast (en ligne), 11 juillet 2025.